-
Partager cette page
Dernières parutions Avril /Mai 2019
Publié le 6 mai 2019 – Mis à jour le 17 juin 2019
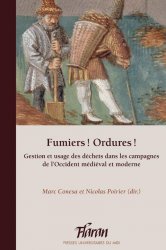 PUM / FRAMESPA / TRACES
PUM / FRAMESPA / TRACESFumiers ! Ordures !
Gestion et usage des déchets dans les campagnes de l’Occident médiéval et moderne
Marc CONESA, Nicolas POIRIER (dir.)
2019 : PUM, 306p. , ISBN : 978-2-8107-0609-9, Prix : 25.00 €
À l’heure du succès des idées « écoresponsables », « anti-gaspillage » et de la promotion du recyclage, l’objectif de ces 38es Journées de Flaran a été de faire le point sur le rapport au déchet dans les campagnes de l’Occident médiéval et moderne : qu’est-ce qui était considéré comme déchet ? Quelles en étaient les chaînes de traitement entre valorisation et simple dépôt ou stockage ?
Une première thématique a concerné le rôle des déjections humaines et animales mais aussi des déchets domestiques (alimentaires) et techniques (de traitement des récoltes) dans les cycles culturaux. Les contributions ont permis de documenter les chaînes opératoires de traitement de ces déchets, depuis leur accumulation jusqu’à leur épandage éventuel dans les parcelles à amender.
Un second axe a envisagé le rôle structurant de ces pratiques du point de vue de la géographie agraire et des ressources environnementales. En effet, le recours à différentes ressources végétales périphériques des finages (buis, ajonc, goémon), comme produit d’amendement, amène à une relecture de l’espace agraire par ses marges.
Enfin, la question des amendements a revisité le dossier des relations ville-campagne dans une perspective inversée et renouvelée. Le colloque a permis de montrer comment la ville approvisionne les campagnes en ordures qui deviennent dès lors des fumures. Le tout est évidemment soumis au système de gouvernement urbain et rural, considérant ces déchets tantôt comme des biens communs affermés au plus offrant, tantôt comme des produits dérivés. Une lecture juridique, administrative et surtout politique de la question a donc été aussi proposée.
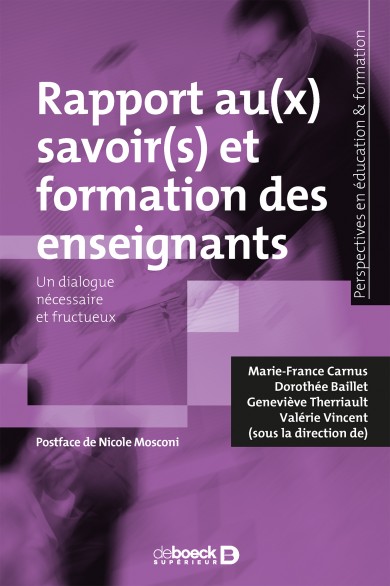 EFTS
EFTS
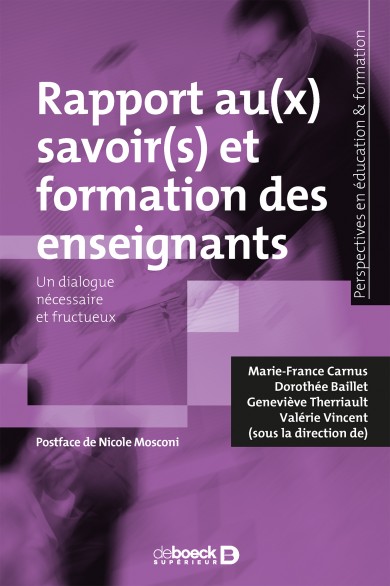 EFTS
EFTSRapport au(x) savoir(s) et formation des enseignants
Un dialogue nécessaire et fructueux
Marie-France Carnus, Dorothée Baillet, Geneviève Therriault, Valérie Vincent (dir.)
2019 : De Boeck Supérieur, ISBN : 9782807318939, 240 p., Prix : 36 €
Dans la continuité de travaux antérieurs, cet ouvrage questionne le dialogue et les articulations possibles entre les recherches sur le rapport au(x) savoir(s) et la formation des enseignants, tous ordres d’enseignement confondus. Suivant des ancrages épistémologiques, théoriques ou méthodologiques variés, les contributions tentent de répondre aux questions suivantes : de quelle nature sont ces articulations ? Quelles sont leurs fonctions ? En quoi et dans quelle mesure les recherches sur le rapport au(x) savoir(s) enrichissent-elles la formation des enseignants ? En retour, comment la formation des enseignants interroge-t-elle les recherches sur le rapport au(x) savoir(s) ?
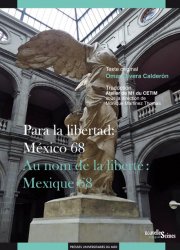 PUM / CETIM
PUM / CETIM
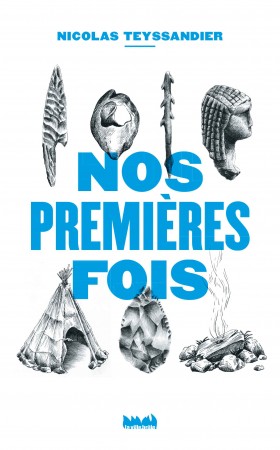 TRACES
TRACES
Nos premières fois
Nicolas Teyssandier
2019 : Ed. la ville brûle, ISBN : 9782360121144, 192 p., Prix : 20 €
 LLA-CREATIS
LLA-CREATIS
Poésie et langues
Aspect théorique et didactique
Michel Favriaud (dir.)*
2019 : Crem/Université de Lorraine, ISSN : 2425-2042
*Michel Favriaud a dirigé la publication et réalisé les entretiens qu'il présente dnas ce numéro spécial de la revue.
Cette livraison renoue avec l’histoire un peu compliquée de la revue Pratiques et de la poésie, jadis au cœur de son projet politique et didactique de rénovation de l’enseignement du français. Mais au fil du temps, les numéros consacrés à la poésie, ou, mieux encore, l’intégrant dans ses problématiques (syntaxe, sémantique, lexicologie, genre, récit, écrit-oral, ponctuation entre autres) étaient devenus rares et de plus en plus pessimistes. Car la poésie, transgenre, trans-régime (linguistique) et peut-être transdisciplinaire, peut opérer, sur la langue et sur l’enseignement, un triple effet, de stimulation, de loupe et de questionnement.
Les poètes et les linguistes renouent ici les fils qu’on avait laissés s’effilocher, malgré les travaux sur la poésie de Saussure, réintégrés dans une leçon moins structuraliste, et ceux mis au jour plus récemment de Benveniste, de Coseriu (sans oublier ceux de Jakobson et Meschonnic) qui nous montrent qu’il y a bien une tradition (indo)européenne et francophone de lien entre poésie et théories de la langue – largement réassurée par Humboldt et Mallarmé au XIXe siècle – qu’il faut faire fructifier, loin d’une théorie de l’écart poétique, qui exclut la poésie de la langue et de la didactique du français. Les didacticiens de FLM et de FLE (soutenus par les poètes), avec leurs manuels, leurs genres d’activités et leurs gestes professionnels, peuvent-ils rester à la traine, au moment où la psychologie cognitive, les théories de la réception littéraire subjective, de la communication empirique et consumériste et de l’ergonomie du travail semblent occuper tout l’espace scientifique et professionnel, et conduire la main des politiques ?
C’est au contraire le bon moment où la poésie, la linguistique et l’écologie de l’apprentissage doivent s’inviter au débat public pour faire en sorte qu’imaginaires singuliers, imaginaires collectifs, configurations littéraires et textuelles d’un côté, et réflexivité raisonnée sur la langue et les œuvres de l’autre épaulent, complètent ou contredisent les précédentes dans « Le Grand Combat » de demain – celui de Michaux et de nous tous – de la lutte contre l’échec scolaire et la marginalisation sociale, et pour l’humanisation démocratique toujours à reconstruire. Demain, à nouveau, la poésie pourra répondre : présente !
2019 : De Boeck Supérieur, ISBN : 9782807318939, 240 p., Prix : 36 €
Dans la continuité de travaux antérieurs, cet ouvrage questionne le dialogue et les articulations possibles entre les recherches sur le rapport au(x) savoir(s) et la formation des enseignants, tous ordres d’enseignement confondus. Suivant des ancrages épistémologiques, théoriques ou méthodologiques variés, les contributions tentent de répondre aux questions suivantes : de quelle nature sont ces articulations ? Quelles sont leurs fonctions ? En quoi et dans quelle mesure les recherches sur le rapport au(x) savoir(s) enrichissent-elles la formation des enseignants ? En retour, comment la formation des enseignants interroge-t-elle les recherches sur le rapport au(x) savoir(s) ?
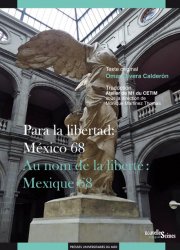 PUM / CETIM
PUM / CETIMPara la libertad : México 68
Au nom de la liberté : Mexique 68
Atelier de M1 du CETIM, M. Martinez (dir.)
2019 : PUM, ISBN : 978-2-8107-0635-8, 108p., Prix : 13 €
Mario et Federico, étudiants en arts plastiques à l’académie San Carlos, préparent l’anniversaire de leur école, une fête placée sous le signe des masques et des déguisements. Ils sont aidés en cela par d’autres comparses parmi lesquels Miguel. Sa sœur, Lucía, éblouie par le talent de Mario, lui demande une entrée pour participer à la fête, malgré l’interdiction de leur mère. Mais c’est précisément le jour de la fête qu’aura lieu la tragédie. Une tragédie qui conduira ces jeunes gens à s’impliquer dans le mouvement étudiant de 1968, tenant ainsi tête au gouvernement, à la société et à leur propre famille, sur fond de musiques et chansons de Joan Manuel Serrat, notamment.
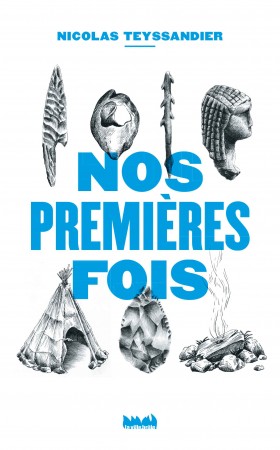 TRACES
TRACESNos premières fois
Nicolas Teyssandier
2019 : Ed. la ville brûle, ISBN : 9782360121144, 192 p., Prix : 20 €
Le préhistorien Nicolas Teyssandier nous livre ici un inventaire très particulier, celui des premières fois de l’humanité, « nos » premières fois : premier outil et premier feu, bien sûr, mais aussi premier dieu, premier mot, première peinture, première leçon, premier enterrement… Ces premières fois culturelles, techniques et matérielles, qui constituent notre mémoire collective, prennent la forme de trente récits aussi vivants que passionnants qui s’appuient sur les connaissances les plus actuelles en préhistoire et en évolution humaine.
Ces histoires d’avant l’Histoire se doublent d’un autre récit, tout aussi passionnant, celui de la façon dont les chercheurs reconstituent notre passé lointain – un travail qui se rapproche par bien des aspects d’une véritable enquête policière, pour reconstruire un passé millénaire à partir de traces matérielles, de fossiles, d’indices ténus et fragiles...
 LLA-CREATIS
LLA-CREATISPoésie et langues
Aspect théorique et didactique
Michel Favriaud (dir.)*
2019 : Crem/Université de Lorraine, ISSN : 2425-2042
*Michel Favriaud a dirigé la publication et réalisé les entretiens qu'il présente dnas ce numéro spécial de la revue.
Cette livraison renoue avec l’histoire un peu compliquée de la revue Pratiques et de la poésie, jadis au cœur de son projet politique et didactique de rénovation de l’enseignement du français. Mais au fil du temps, les numéros consacrés à la poésie, ou, mieux encore, l’intégrant dans ses problématiques (syntaxe, sémantique, lexicologie, genre, récit, écrit-oral, ponctuation entre autres) étaient devenus rares et de plus en plus pessimistes. Car la poésie, transgenre, trans-régime (linguistique) et peut-être transdisciplinaire, peut opérer, sur la langue et sur l’enseignement, un triple effet, de stimulation, de loupe et de questionnement.
Les poètes et les linguistes renouent ici les fils qu’on avait laissés s’effilocher, malgré les travaux sur la poésie de Saussure, réintégrés dans une leçon moins structuraliste, et ceux mis au jour plus récemment de Benveniste, de Coseriu (sans oublier ceux de Jakobson et Meschonnic) qui nous montrent qu’il y a bien une tradition (indo)européenne et francophone de lien entre poésie et théories de la langue – largement réassurée par Humboldt et Mallarmé au XIXe siècle – qu’il faut faire fructifier, loin d’une théorie de l’écart poétique, qui exclut la poésie de la langue et de la didactique du français. Les didacticiens de FLM et de FLE (soutenus par les poètes), avec leurs manuels, leurs genres d’activités et leurs gestes professionnels, peuvent-ils rester à la traine, au moment où la psychologie cognitive, les théories de la réception littéraire subjective, de la communication empirique et consumériste et de l’ergonomie du travail semblent occuper tout l’espace scientifique et professionnel, et conduire la main des politiques ?
C’est au contraire le bon moment où la poésie, la linguistique et l’écologie de l’apprentissage doivent s’inviter au débat public pour faire en sorte qu’imaginaires singuliers, imaginaires collectifs, configurations littéraires et textuelles d’un côté, et réflexivité raisonnée sur la langue et les œuvres de l’autre épaulent, complètent ou contredisent les précédentes dans « Le Grand Combat » de demain – celui de Michaux et de nous tous – de la lutte contre l’échec scolaire et la marginalisation sociale, et pour l’humanisation démocratique toujours à reconstruire. Demain, à nouveau, la poésie pourra répondre : présente !







