- Recherche,
-
Partager cette page
Dernières parutions Janv 18
Publié le 23 janvier 2018 – Mis à jour le 18 septembre 2018
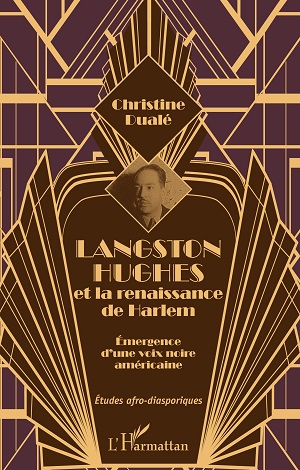 CAS
CASLangston Hughes et la Renaissance de Harlem : émergence d’une voix noire américaine.
Christine Dualé
2017 : L’Harmattan, 308 p., ISBN 978-2-343-13767-4, Prix 32 €
Comment Langston Hughes, poète américain majeur du XXe siècle pendant la Renaissance de Harlem, procéda-t-il pour s'approprier et restituer l'esthétique jazz dans son œuvre ?
En inscrivant son écriture dans un nouveau territoire langagier, il s'imposa à travers un style qui puise son souffle dans la riche tradition musicale africaine américaine, et contribua au décentrement et à la dé-marginalisation de la culture noire américaine.
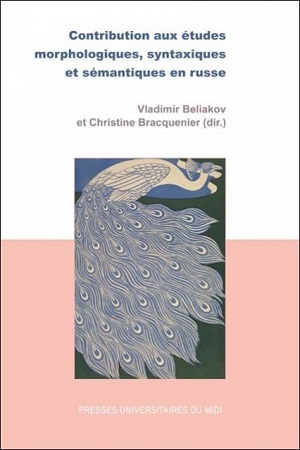 CLLE / PUM
CLLE / PUMContribution aux études morphologiques, syntaxiques et sémantiques en russe
Vladimir Beliakov, Christine Bracquenier (dir.)
2017 : Presses Universitaires du Midi, 246 p., ISBN 978-2-8107-0523-8, Prix 20 €
Le présent ouvrage, consacré à l’étude des relations entre la morphologie, la syntaxe et la sémantique, comporte un ensemble de douze contributions de chercheurs reconnus dans ce domaine. La problématique abordée ici en tenant compte de différentes approches théoriques et de diverses traditions de recherche se trouve à la croisée des questions fondamentales du fonctionnement de la langue russe.
Ce volume regroupe des travaux qui portent tantôt sur un lexème dans son environnement syntaxique, tantôt sur la sémantique d’une structure syntaxique donnée, sur les relations entre la forme du mot et son sens, entre la signification et le sens, sur la phraséologie, ou encore sur le rôle de tel ou tel élément dans la construction et la cohésion du texte, ou sur celui des métatermes dans l’analyse de la langue. Ces études, menées essentiellement en synchronie, concernent pour la plupart la langue russe contemporaine, mais une contribution consacrée au vieux russe montre combien la connaissance des états anciens de la langue peut être éclairante pour la perception des faits de langue actuels. Ainsi ce recueil propose-t-il des éléments de réflexion sur la question de la possible ou impossible autonomie de la morphologie et de la syntaxe par rapport au sens, et il vise à démontrer qu’il apparaît nécessaire d’analyser les structures de la langue dans une optique plurielle afin d’appréhender leur complexité d’un point de vue plus global, systémique.
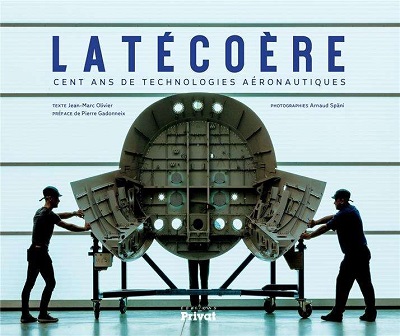 FRAMESPA
FRAMESPALatécoère cent ans sous le signe des technologies aéronautiques
Jean-Marc Olivier
2017 : Privat, 160 p., ISBN 9782708992764, Prix 32 €
En produisant ses premiers avions dans son usine de Montaudran dès 1917, Latécoère symbolise la naissance de l'aéronautique à Toulouse. Puis les lignes Latécoère, plus grande compagnie aérienne internationale au début des années 1920, engendrent directement l'Aéropostale de Mermoz et Saint-Exupéry. Aujourd'hui, ce sous-traitant de premier rang travaille aussi bien pour Airbus que pour Boeing ou Dassault, employant plus de 5000 personnes à travers le monde (Tunisie, Maroc, Mexique, Brésil...), dont la moitié en France. Latécoère participe donc à tous les grands défis de l'aéronautique depuis cent ans.
Pionnier dans la traversée de l'Atlantique Sud et dans la construction des hydravions géants, le groupe s'implique ensuite dans l'élaboration des premiers missiles français, puis dans la maîtrise de l'électronique embarquée et des matériaux composites.
L'entreprise, d'abord très familiale, expérimente aussi des formes originales de gestion, passant d'un RES (Reprise de l'Entreprise par ses Salariés) en 1989 à une nouvelle recomposition récente de son capital avec les fonds d'investissement américain et luxembourgeois Monarch et Apollo. Le goût de l'aventure et du défi technique apparaît consubstantiel de Latécoère et ce livre en décrit les étapes successives, revenant sur les « glorieux ancêtres » d'avant 1940 tout en insistant sur les multiples expériences des soixante-dix dernières années.
Ultime originalité dans l'univers très masculin de l'aéronautique, le groupe est dirigé depuis novembre 2016 par une femme : Yannick Assouad, ancienne directrice générale de la branche Cabin de Zodiac Aerospace.
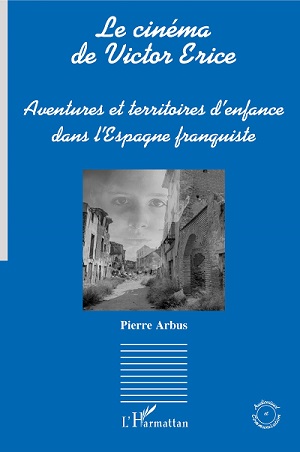 LARA-SEPPIA
LARA-SEPPIALe cinéma de Victor Erice. Aventures et territoires d'enfance dans l'Espagne franquiste
Pierre Arbus
2017 : L’Harmattan, 364 p., ISBN 978-2-343-12780-4, Prix 37 €
Le cinéma de Victor Erice (1940) est un cinéma rare, inscrit dans le contexte de l'histoire douloureuse des 35 ans de la dictature franquiste en Espagne. Cette étude interroge la présence et le devenir d'un impensé volontaire dans trois films du cinéaste espagnol : El Espiritu de la colmena (1973), El Sur (1983) et Alumbramiento (2002).
Erice filme les aventures de l'enfance, les territoires où se déroule ses micro-histoires. Le processus de création des fragments audiovisuels y est central et porte les germes de la résistance.
 LLA CREATIS
LLA CREATISDu pantin à l'hologramme - Le personnage désincarné sur la scène hispanophone contemporaine
Dominique Breton, Emmanuelle Garnier, Vanessa Saint-Martin et Fanny Blin (ed.)
2017 : Editions ORBIS TERTIUS, 304 p., ISBN 978-2-36793-094-0, Prix 29,90 €
Le personnage semble être le composant fondamental de l’acte théâtral au point de constituer la clé de voûte du principe même de représentation canonique. Il apparaît, par la médiation de l’interprétant, comme un corps « incarné », parlant et agissant, qui contribue à générer le fameux paradoxe de l’acte théâtral et fait dire au spectateur confronté au personnage scénique : c’est vrai, et ce n’est pas vrai ; c’est moi, et ce n’est pas moi.
La remise en question de l’illusion référentielle perçue comme vaine et mensongère, scellant la disparition de la mimésis et de la fable, fait émerger un théâtre dit « postdramatique » qui oblige à repenser la fausse évidence de cette parfaite adéquation entre acteur et personnage.
L’éclatement de la triade acteur–corps–personnage et la fin de la médiation exclusive de l’acteur comme voie d’accès à celui-ci repose avec force la question du corps et celle du discours proféré sur scène : le corps ne représentant plus nécessairement le personnage (tout au moins, plus de façon exclusive), comment identifier ce dernier et interpréter sa présence, quelle est désormais sa fonction, son statut dans l’acte théâtral qui le relie au spectateur ? Est-ce à dire qu’avec le principe de désincarnation et les différentes modalités de dislocation, de dissémination, d’évacuation radicales ou partielles du « personnage » sur la scène, disparaît en même temps le principe d’identification ? Les différentes voies / voix explorées par les scènes hispaniques contem¬poraines ne contribuent-elles pas précisément à faire évoluer le concept du personnage incarné et à réinventer de nouvelles formes de « catharsis » et de dénégation ?







