-
Partager cette page
Dernières parutions Janv 19
Publié le 29 janvier 2019 – Mis à jour le 20 février 2019
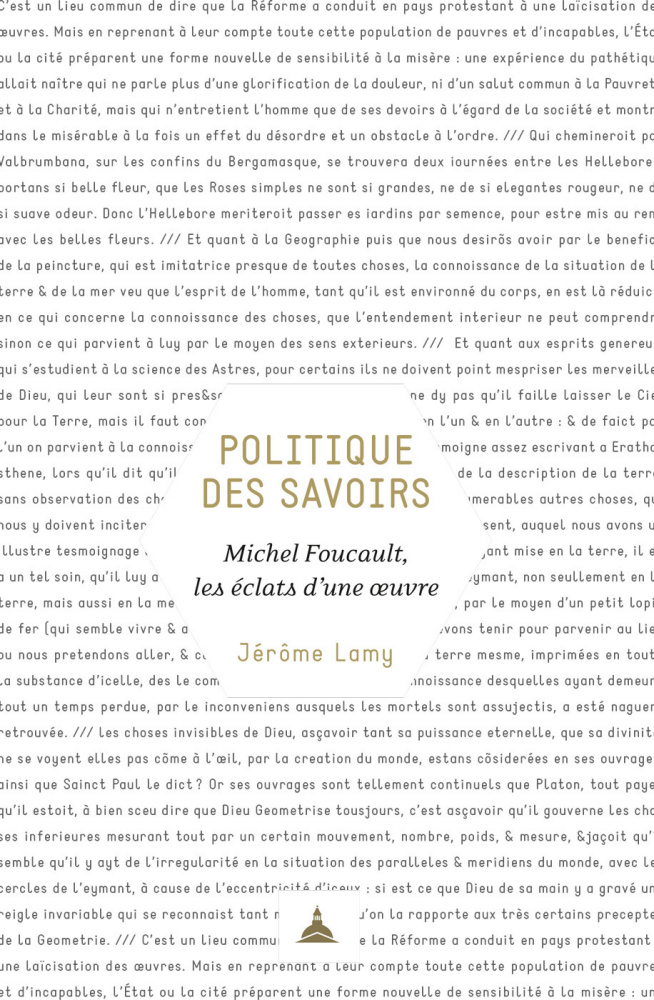 CERTOP
CERTOPPolitique des savoirs / Michel Foucault, les éclats d'une œuvre
Jérôme Lamy
2019 : Éditions de la Sorbonne, 180 p., ISBN 979-10-351-0283-8, Prix 19 €
Le rapport entre savoirs et pouvoirs sourd dans toute l'œuvre de Michel Foucault. En investissant les différentes formes de leur articulation, le philosophe s’est efforcé de conceptualiser la production des normes, la constitution du sujet moderne, les seuils de scientificité, les modalités de gouvernement autant que les discours prenant le corps pour objet. En filigrane émerge une histoire des régimes de vérité, qui fait toute sa place à la vérité scientifique dans sa capacité à contraindre l’action. Cet ouvrage déplie quelques-unes des tentatives foucaldiennes de penser les politiques de savoir en se saisissant de la question de l’écart, de la distance et de l’intervalle entre savoir et pouvoir. Plutôt que d’appliquer une grille qui aurait été élaborée sur des objets divers, c’est à la fois une restitution généalogique et une mise à l’épreuve des propositions et des concepts du philosophe – l’épistémè, la biopolitique, l’hétérotopie – qui sont proposées ici : en ce sens, ce recueil est un parcours dans l’épaisseur des écrits foucaldiens.
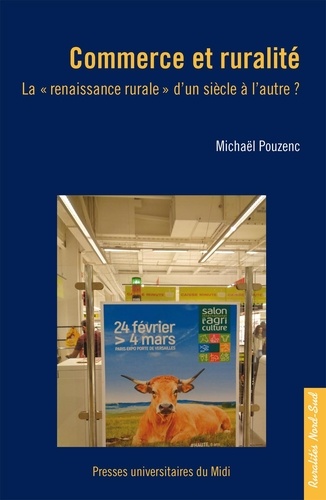 LISST
LISSTCommerce et ruralité / La « renaissance rurale » d’un siècle à l’autre ?
Mickaël Pouzenc
2019 : Presses Universitaires du Midi, 192 p., ISBN 978-2-8107-0605-1, Prix 20 €
L’analyse des rapports entre commerce et ruralité permet de revisiter l’analyse proposée par B. Kayser en termes de « renaissance rurale ». Cette synthèse des réflexions menées des années 1970 aux années 1990 était centrée sur les spécificités du rural (spécificités d’activités économiques, de structure spatiale, d’organisation sociale, de valeurs et de représentations). L’analyse des travaux de prospective des années 2000 et 2010 montre qu’une partie de ces spécificités a été largement évacuée des réflexions récentes. Or, leur prise en compte fait ressortir les nombreuses reformulations en cours de la catégorie « espaces ruraux », à condition de faire porter la réflexion non pas simplement sur les rapports des ruraux à leur espace mais sur les rapports qu’entretient l’ensemble de la société avec ses espaces de faible densité.
La mutation du commerce alimentaire sous toutes ses formes (petits commerces indépendants, grande distribution, circuits courts…) témoigne des voies diversifiées par lesquelles la société actuelle cherche à renouveler ses ruralités, entendues comme ses rapports productifs à la nature, indissociables de rapports sociaux et culturels. Il ressort alors que la « fabrique de la ruralité » fonctionne à plein dans une société de consommation qui idéalise les espaces ruraux pour se rassurer, prendre soin de soi, réaliser son projet personnel ou faire société, dans une société de développement durable qui valorise le bio et l’équitable, dans une société mondialisée qui valorise les dynamiques locales et dans une société de mobilités qui reproduit des configurations spatiales spécifiques.
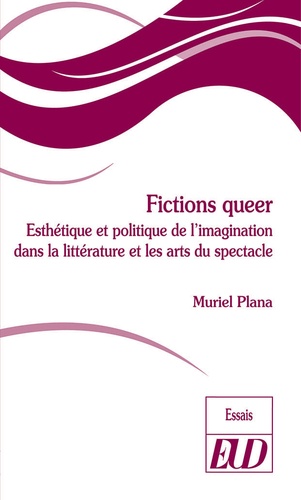 LLA CREATIS
LLA CREATISFictions queer - Esthétique et politique de l'imagination dans la littérature et les arts du spectacle
Muriel Plana
2018 : Editions universitaires de Dijon, 160 p., ISBN 978-2-36441-280-4, Prix 10 €
Cet essai se propose de définir une nouvelle forme de fable, la fiction queer, et d'en montrer la pertinence esthétique et politique en contexte postmoderne. En effet, dans la mesure où elle expérimente, par le libre travail de l'imagination, d'autres pensées du corps et des relations humaines, elle remet en question les évidences du genre, des sexualités et des identités sociales dont nous héritons : elle échappe de même aux dispositifs formels dominants et aux idéologies postmodemistes en s'écartant de la réalité sur un mode dialogique, ce qui lui permet de la saisir, de l'interroger, de la critiquer et de la réinventer.
Composé d'un volet théorique et de trois analyses d'œuvres exemplaires (roman, théâtre-musique, cinéma), Fictions queer se présente comme une poétique alternative pour la littérature et les arts du spectacle d'aujourd'hui.
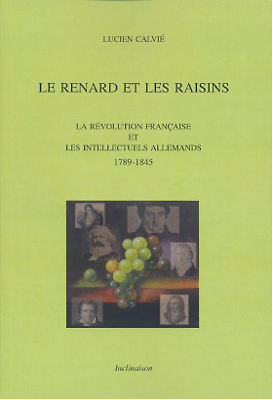 CREG
CREGLe renard et les raisins / La Révolution Française et les Intellectuels allemands, 1789-1845
Lucien Calvié
2018 : Editions Inclinaison, 294 p., ISBN 978-2916942636, Prix 18 €
Pour le bicentenaire de la naissance de Marx (1818), ce livre, d'abord paru pour celui de 1789, interroge la " chute du Mur" : révolution démocratique ou restauration d'une unité perdue après la " catastrophe " nazie ? Mais de l'avis, en 2002, d'un historien allemand de large audience, une révolution réussie, en 1848, puis en 1918, aurait aussi été une " catastrophe" allemande. C'est là le contrepied de Ruge, hégélien de gauche attaché au modèle de 1789, qui notait en 1844 : "II n'y a pas de peuple allemand et seule une révolution pourrait le créer". Les compléments de cette réédition, s'ajoutant aux chapitres sur Kant, Schiller, le "jacobinisme", Novalis, Hegel, Heine, Börne, la Jeune Allemagne et la Gauche hégélienne, Marx inclus, concernent le " jacobin " Rebmann lecteur de Constant, Fichte et la question nationale, F. Schlegel et le romantisme politique et le couple hölderlinien Antiquité-Révolution. Parmi ces réactions allemandes au processus révolutionnaire, versions successives de la fable du renard et des raisins, une exception frappe, celle de Hegel, penseur du réel historique et politique. Le " matérialisme historique " de Marx prolonge le " réalisme " hégélien, mais peut aussi être compris comme un nouvel avatar de l'idéalisme allemand : dualité d'un philosophe parmi les plus grands s'efforçant de saisir au plus prés le concret de la société et de l'histoire. Hegel, puis Marx relient, en pensée, les révolutions politiques, bourgeoises, " atlantiques", libérales et démocratiques des XVIIe et XVIIIe siècles (Angleterre, Etats-Unis et France) aux révolutions sociales, prolétariennes, orientales et " marxistes " du XXe (Russie et Chine).
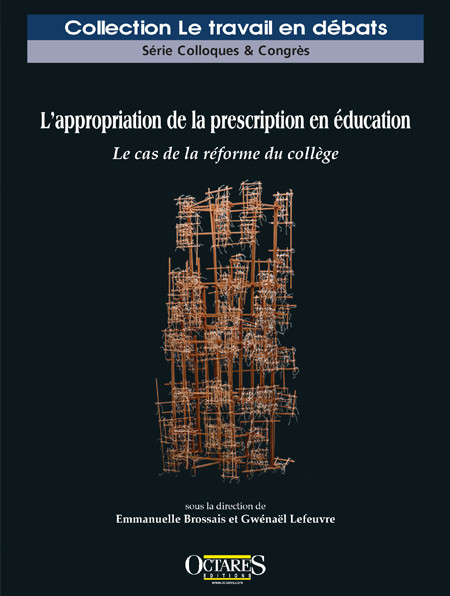 EFTS
EFTSL’appropriation de la prescription en éducation - Le cas de la réforme du collège
Emmanuelle Brossais et Gwénaël Lefeuvre (dir.)
2018 : Editions Octares, 204 p., ISBN 978-2-36630-084-0, Prix 24 €
Comment les différents acteurs de l’École, au sein de leurs pratiques quotidiennes, s’approprient-ils individuellement et collectivement une réforme ?
En 2016-2017, la refondation du système scolaire français est passée par la mise en œuvre d’une nouvelle réforme au collège. Ouvrir les coulisses de la réforme du collège : telle est l’ambition de cet ouvrage réalisé par une équipe de chercheurs en sciences de l’éducation.
Destiné aux chefs d’établissement, aux enseignants, aux décideurs politiques, aux formateurs, aux inspecteurs, aux étudiants, aux chercheurs, l’ouvrage décrit les processus de fabrication de la réforme du collège.
L’originalité du travail des auteurs consiste à avoir collecté et analysé des données de recherche inédites, à partir de relevés de terrain qui privilégient l’observation et la prise en compte du point de vue des sujets.
L’ouvrage est structuré en trois parties : la première partie s’intitule « Réformer l’école : finalités, outils et dispositifs, pour quel(s) changement(s) ? ». Centrée sur les dimensions politiques, sociales et historiques de la réforme, elle la situe dans le contexte des politiques éducatives internationales. La deuxième partie porte sur les modalités d’accompagnement des acteurs professionnels dans la conception et la mise en œuvre d’une réforme au collège, en particulier en étudiant le rôle des chefs d’établissement. La troisième partie analyse la manière dont certains dispositifs prescrits, comme les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’accompagnement personnalisé (AP), affectent les pratiques des acteurs éducatifs dans leur contexte local.
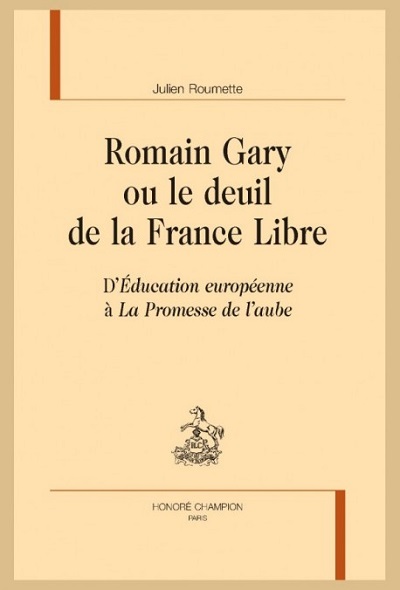 PLH
PLH Romain Gary ou le deuil de la France libre / D'"Éducation européenne" à "La Promesse de l'aube"
Julien Roumette
2018 : Honoré Champion, 316 p., ISBN 9782745350022, Prix 45 €
« Je vais vous dire. Je suis resté profondément un Français libre » : en 1968, plus de vingt ans après la fin de la guerre, Romain Gary continuait à se définir par son engagement dans la France Libre. Chez cet éternel déraciné, ce sentiment d’appartenance était plus fort que tout. La France Libre, écrit-il, est « la seule tribu à laquelle j’ai appartenu à part entière ».
Pourtant, on peut se demander ce que signifie cette fidélité au regard d’une oeuvre qui refuse le cadre étroit de la littérature engagée et revendique de ne pas commémorer et de très peu raconter la guerre.
Pour trouver sa voie comme écrivain, il aura fallu à Gary surmonter l’amertume et les désillusions de l’après-guerre, mettre à mort symboliquement son personnage d’ancien combattant, et faire renaître le combat de la France Libre sous d’autres formes. C’est au prix d’une métamorphose de son idéalisme que son univers romanesque trouve progressivement son ton et son équilibre propres, marqués par un humour provocateur et salutaire.
Cette étude est consacrée à la première grande période créatrice de l’écrivain, de son premier roman publié, Éducation européenne, jusqu’à La Promesse de l’aube, où il parvient enfin à raconter directement sa guerre, en un hommage qui est aussi une forme d’adieu. L’approche, avant tout littéraire, met en lumière la dynamique d’une oeuvre indissociable d’une vision historique et d’un engagement, sans jamais pourtant être réductible uniquement à eux. Elle restitue le parcours initial de l’écrivain, rappelant l’intérêt et l’importance de ses premières œuvres, souvent méconnues, soulignant leur invention formelle, et leur redonnant la place qui est la leur dans un tableau de la littérature d’après-guerre dont elles ont été trop souvent artificiellement écartées.
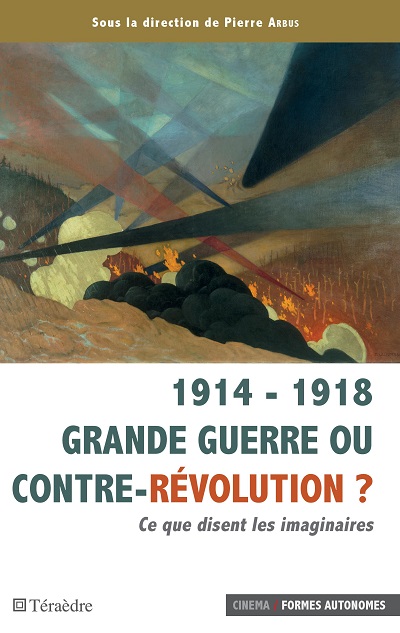 LARA-SEPPIA
LARA-SEPPIA1914 - 1918 Grande guerre ou contre-révolution ? Ce que disent les imaginaires
Pierre Arbus (dir.)
2019 : L'Harmattan, 280 p., ISBN 978-2-36085-092-1, Prix 29 €
Les célébrations du Centenaire terminées, il est nécessaire d'examiner ce que disent aujourd'hui de la guerre ces propositions. Comme autant de métamorphoses poétiques de la mémoire souvent délaissées au lendemain des grands événements de l'Histoire au profit des archives officielles et de la parole autorisée, cette étude se veut un éclairage des contenus explicites des témoignages individuels.







