-
Partager cette page
Dernières parutions Nov 18
Publié le 20 novembre 2018 – Mis à jour le 12 décembre 2018
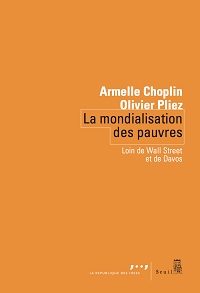 LISST
LISSTLa mondialisation des pauvres. Loin de Wall Street et de Davos
Armelle Choplin, Olivier Pliez
2018 : La République des idées - Seuil, 128 p., ISBN 978.2.02.136652.5, Prix 11.80 €
La mondialisation ne se résume pas au succès de quelques multinationales et à la richesse d’une minorité de nantis. Les acteurs les plus engagés dans la mondialisation demeurent discrets, souvent invisibles.
Depuis une trentaine d’années, les routes de l’échange transnational ont connu de profondes mutations. Elles relient aujourd’hui la Chine, l’atelier du monde, à un « marché des pauvres » fort de quatre milliards de consommateurs, en Algérie, au Nigeria ou en Côte d’Ivoire. Pour apercevoir ces nouvelles « Routes de la Soie », il faut se détacher d’une vision occidentalo-centrée et déplacer le regard vers des espaces jugés marginaux, où s’inventent des pratiques globales qui bouleversent l’économie du monde. On découvre alors une « autre mondialisation », vue d’en bas, du point de vue des acteurs qui la font.
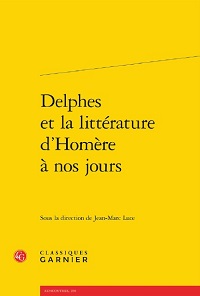 PLH
PLHDelphes et la littérature d’Homère à nos jours
Jean-Marc Luce (dir.)
2018 : Classiques Garnier, 480 p., ISBN 978-2-406-07428-1, Prix 57 €
Cet ouvrage tente de suivre les changements qui n’ont cessé de remodeler l’image de Delphes dans la littérature, d’Homère aux auteurs les plus contemporains.
On y aborde la poésie et la littérature savante de l’Antiquité, puis la littérature et la musique du XIXe siècle à aujourd’hui.
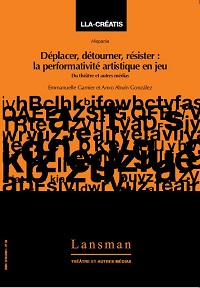 LLA CREATIS
LLA CREATISDéplacer, détourner, résister : la performativité artistique en jeu (Du théâtre et autres médias)
Emmanuelle Garnier, Anxo Abuín González
2018 : Lansman Editeur, 236 p., ISBN 978-2- 8071-0190-6, Prix 16 €
La recherche en art a largement montré la manière dont la performance a pénétré les tissus perméables de la création artistique occidentale depuis un siècle. Au fondement de ce phénomène : le renversement de la raison hégémonique, la disparition des idéaux normatifs qui présidaient à la modernité et la mise en œuvre de nouvelles modalités de régulation sociale. Le décloisonnement disciplinaire a ouvert la porte à toutes sortes d’hybridations techniques, génériques et esthétiques, obligeant la critique à concevoir de nouveaux concepts pour comprendre ce qui se joue à la confluence bouillonnante des médias artistiques, où les formes se disséminent, dans le temps, dans l’espace, et où les lignes de partage s’estompent dans les régimes de perception, de sensation et d’interprétation. Parfois, l’expérience performatique a noué un dialogue avec les disciplines artistiques traditionnelles : le théâtre s’est ainsi vu bousculé par une approche plus plasticienne de la scène, une sortie des espaces institutionnellement dédiés, une privation du récit et de la représentation au sens large, ou par des modes d’écriture scéniques s’affranchissant de « pré-texte », et par l’invasion des nouvelles technologies. Parfois, encore, le théâtre a pu, à l’inverse, être utilisé pour polliniser d’autres arts institués, comme la poésie ou le cinéma, notamment par le biais de sa théâtralité ou de sa performativité.
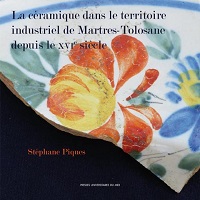 FRAMESPA / PUM
FRAMESPA / PUMLa céramique dans le territoire industriel de Martres-Tolosane depuis le XVIe siècle
Stéphane Piques
2018 : Presses Universitaires du Midi, 264 p., ISBN : 978-2-8107-0547-4, Prix 25 €
Située entre Toulouse et les Pyrénées, Martres-Tolosane est renommée pour son artisanat faïencier. Si les amateurs connaissent de réputation cette ville, moins nombreux sont ceux qui savent que l’histoire de l’activité céramique de ce territoire est bien plus ancienne que le XVIIIe siècle. Dès la Renaissance, des potiers s’implantent dans des villages proches de la « cité artiste ». S’adaptant aux changements techniques et artistiques, ces artisans d’art ont su construire et pérenniser au fil des siècles un savoir-faire reconnu encore aujourd’hui pour sa qualité.
C’est en associant l’histoire de l’art à l’histoire de l’économie et à l’archéologie que l’auteur se propose de montrer comment ces céramistes ont su inscrire dans la longue durée une activité à un territoire, faisant de cette céramique un « produit de terroir ».
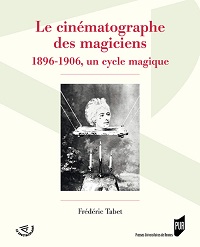 LARA-SEPPIA
LARA-SEPPIACinématographe des magiciens: 1896-1906, un cycle magique
Frédéric Tabet
2018 : Presses universitaires de Rennes, ISBN-13: 978-2753573178, Prix 30 €
Ce livre propose une étude des relations entre l’art magique et le cinématographe. Aux débuts du cinéma, les prestidigitateurs, illusionnistes ou manipulateurs ont projeté et parfois produit des films étonnants ; chaque genre se retrouve dans leur manière de penser cette nouvelle machine, qui s’amalgame à leur spectacle. Partant des origines des escamoteurs, l’évolution de la prestidigitation à la fin du XIXe mène à l’illusionnisme. Les créations de Buatier de Kolta implantent ce paradigme scientifique qui régénère la magie optique, tel son brevet du théâtre noir qui propose en 1888, une écriture lumineuse de l’espace. À partir de 1900, les représentations françaises de Leopoldo Fregoli empruntent une autre voie et repoussent les limites des pièces magiques. Son spectacle ne repose plus sur l’altération des identités précédemment mises en ½uvre, mais sur le choc des attractions propre aux music-halls. Finalement, la figure du manipulateur, qui s’insinue entre autres lors des tournées de Gaston Velle, interroge les magiciens sur la place que doit tenir l’habileté manuelle. Paradoxalement, ces numéros divisent autant qu’ils structurent les premiers groupements corporatifs. L’ensemble de ces évolutions techniques et esthétiques peut s’appréhender en cycle, dont on retrouve les fondements dans la filmographie de Georges Méliès et plus généralement dans la pensée et l’écriture magique du cinéma







