- Recherche,
-
Partager cette page
Dernières parutions Sept 17
Publié le 25 septembre 2017 – Mis à jour le 20 octobre 2017
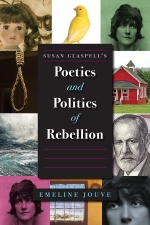 CAS
CASSusan Glaspell’s Poetics and Politics of Rebellion
Emeline Jouve
2017 : University of Iowa Press (Coll. Studies in Theatre History & Culture), 260 p., ISBN 9781609385088, Prix $65.00
“In Susan Glaspell’s Poetics and Politics of Rebellion, Emeline Jouve has cleared away what Lawrence Langer once called Glaspell’s ‘old lace’ to reveal the ‘steel lining beneath the tender surface’—the politics and, really, outrage at injustice and belief in democratic idealism that are at the center of Glaspell’s dramaturgy—and her raison d’être as a writer.”—Drew Eisenhauer, Coventry University
A pioneer of American modern drama and founding member of the Provincetown Players, Susan Glaspell (1876–1948) wrote plays of a kind that Robert Brustein defines as a “drama of revolt,” an expression of the dramatists’ discontent with the prevailing social, political, and artistic order. Her works display her determination to put an end to the alienating norms that, in her eyes and those of her bohemian peers, were stifling American society. This determination both to denounce infringements on individual rights and to reform American life through the theatre shapes the political dimension of her drama of revolt.
Analyzing plays from the early Trifles (1916) through Springs Eternal (1943) and the undated, incomplete Wings, author Emeline Jouve illustrates the way that Glaspell’s dramas addressed issues of sexism, the impact of World War I on American values, and the relationship between individuals and their communities, among other concerns. Jouve argues that Glaspell turns the playhouse into a courthouse, putting the hypocrisy of American democracy on trial. In staging rebels fighting for their rights in fictional worlds that reflect her audience’s extradiegetic reality, she explores the strategies available to individuals to free themselves from oppression. Her works envisage a better future for both her fictive insurgents and her spectators, whom she encourages to consider which modes of revolt are appropriate and effective for improving the society they live in. The playwright defines social reform in terms of collaboration, which she views as an alternative to the dominant, alienating social and political structures. Not simply accusing but proposing solutions in her plays, she wrote dramas that enacted a positive revolt.
A must for students of Glaspell and her contemporaries, as well as scholars of American theatre and literature of the first half of the twentieth century.
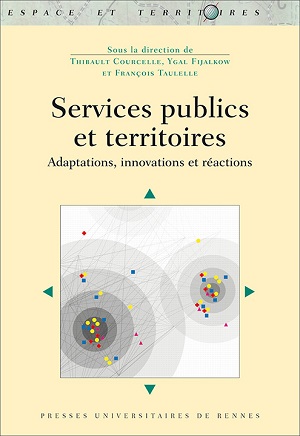 CERTOP
CERTOPServices publics et territoires / Adaptations, innovations et réactions
Thibault Courcelle, Ygal Fijalkow et François Taulelle (dir.)
2017 : Presses Universitaires de Rennes, 254 p., ISBN 978-2-7535-5389-7, Prix 22 €
Le redéploiement spatial et la réorganisation des services publics se sont effectués sans vision d’ensemble, sans connaître les réalités (géographiques, sociales, économiques) propres aux territoires concernés. Le processus est avant tout guidé par des instruments d’inspiration managériale qui répondent au souci de rationaliser l’argent investi, en apportant une meilleure qualité de service, au meilleur coût. Si les objectifs poursuivis sont de bon sens et se justi fient d’autant plus facilement en période de crise, il est dif ficile d’en mesurer les effets.
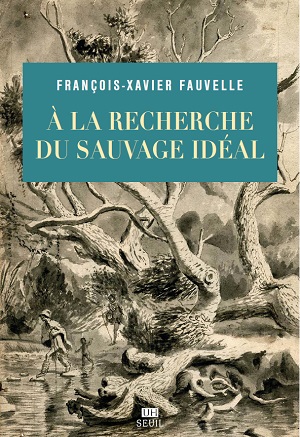 TRACES
TRACESA la recherche du sauvage idéal
François-Xavier Fauvelle
2017 : Editions du Seuil, 224 p., ISBN 978.2.02.137017.1, Prix 20 €
Ce livre nous entraîne au bout de l’Afrique sur les traces d’un peuple oublié, ce peuple dont est issu la tristement célèbre « Vénus hottentote ». Dès qu’il paraît, au temps des Grandes Découvertes, son étrangeté radicale effraie ou émerveille. Voici donc le pire ou le meilleur des sauvages, en tout cas le plus exemplaire : il est ce que nous – Européens, modernes, conquérants – ne pouvons plus être. Inadaptés au monde qui se construit à leurs dépens, ces femmes et ces hommes deviennent la caricature d’un peuple meurtri, bientôt retranché de la terre et de l’histoire. Parce qu’il retrace à la fois leur disparition et l’enquête qui part à leur recherche, ce livre raconte l’histoire à rebours. Il suit des pistes qui remontent le temps et les retrouve, en 1670, entourés de vaches et d’esprits, dans le campement où un chirurgien allemand, notre meilleur informateur, les a rencontrés. Ils ont un nom : les Khoekhoe.
« Je ne sais pas s’il faut haïr les voyages et les explorateurs. Ils vous convient, quelquefois malgré eux, à un outrepassement auquel il faut consentir. Au bout de la piste, si nous y avons consenti, si nous y avons mis assez de désir et de ténacité, peut-être serons-nous tous, le narrateur à coup sûr, la lectrice, le lecteur peut-être, devenus sauvages. »
F.-X. F.
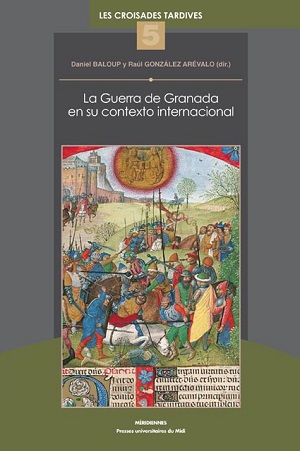 FRAMESPA / PUM
FRAMESPA / PUMLa Guerra de Granada en su contexto internacional
Daniel Baloup, Raúl Gonzalez Arévalo (dir.)
2017 : Presses Universitaires du Midi, 344 p., ISBN 978-2-8107-0460-6, Prix 25 €
La historiografía tradicional, española y europea, ha considerado la Guerra de Granada (1482-1492) como un hecho de naturaleza y alcance exclusivamente hispánicos. Se trataba del último episodio de un proceso ibérico, la « Reconquista », el enfrentamiento secular entre el Islam y la Cristiandad, consustancial al Medievo peninsular. El nacionalismo romántico del siglo XIX y la dictadura de Franco (1939-1975) lo marcaron a fuego en la identidad nacional española.
Sin embargo, en las últimas décadas se han revisado estos postulados, hasta culminar en una revisión radical. Librado el conflicto de la carga ideológica que lastraba su estudio, se ha podido abordar bajo una luz nueva, que tiene un doble marco infinitamente más amplio y complejo. De una parte, las Guerras de Granada –en plural– como manifestación ibérica de lo que en Europa se ha denominado « cruzadas tardías ». De otra, el reordenamiento geopolítico del Mediterráneo, como un tablero de ajedrez, en el que el Islam avanzaba en Levante y retrocedía en Occidente. El presente volumen reúne textos de especialistas europeos que abordan tanto las cruzadas contra el Reino de Granada en el siglo XIV –con participación de borgoñones, escoceses, franceses e ingleses– como la guerra final de conquista en el siglo XV. Se identifican los canales de difusión de noticias, la implicación y diferente repercusión en las cortes renacentistas de la Península Italiana, o el eco atenuado de las hostilidades en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Emerge así una imagen insólita, novedosa, de un conflicto de dimensión y alcance internacionales.
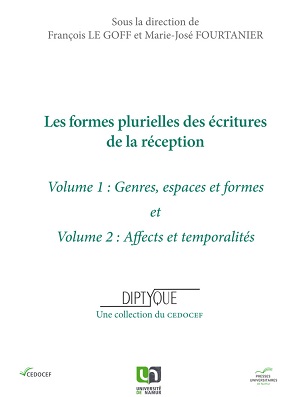 LLA CREATIS
LLA CREATISLes formes plurielles des écritures de la réception Vol. 1 et 2
François Le Goff, Marie-José Fourtanier (dir.)
2017 : Editions de Namur (Coll. Diptyque), 540 p., ISBN 978-2-87037-974-5, Prix 39 €
Depuis près de vingt ans, la communauté des chercheurs en didactique de la littérature s'est attachée à décrire et à interroger les expériences de lecture littéraire dans la formation des élèves, des étudiants, des enseignants. La diversité des études a montré combien la dimension scripturale constitue un paradigme clé dans les apprentissages de la lecture littéraire et dans la formation d’un sujet-lecteur. Écriture-trace, écriture-mémoire, l’écriture prolonge la lecture et joue un rôle déterminant dans les dispositifs d’évaluation de l’école à l’université. À rebours, l’attention portée au développement de la compétence esthétique et l’importance accordée à l’activité du lecteur ont libéré les pratiques d’écriture, tracé de nouvelles voies et confirmé leur valeur heuristique.
Comment sont identifiées, classées, les écritures de la réception dans les curricula des différents systèmes éducatifs ? Dans quelle mesure la pratique experte - celle de l’artiste, celle de l’écrivain dans sa correspondance, dans ses carnets, par exemple - intervient-elle dans les dispositifs de formation ? Quelles formes peut prendre à l’école et à l’université le discours sur l’œuvre ? Quels rapports l’expression singulière du lecteur entretient-elle avec les formes rhétoriques en usage ou les langages de spécialité, de nature métatextuelle ?
Les textes de cet ouvrage en deux volumes apportent des éclairages multiples et complémentaires à ces questions sensibles de la réception des textes littéraires, de la trace laissée du souvenir de lecture et des modes d’expression du texte du lecteur. Ils témoignent, chacun à leur manière, de la nécessité de penser l’enseignement de la littérature dans une étroite association de la lecture et de l’écriture, émancipée des cadres rhétoriques du commentaire.







